Sous l’ombre d’une vigne aux fruits rouges dont le feuillage déborde pour faire l’ombre à partir du mi printemps, adossé sur une banquette : Une sorte de mur de bas niveau recouvert d’un crépissage de terre et de bouse de vache qu’on trouve par ailleurs sous forme de véranda (asqif) dans d’autres constructions, faisant office d’air de repos pour les passants et d’introduction à la maison pour les visiteurs, mon grand père Kaci me regardait partir déjà enfant à Sidi El Moufek ou ma famille m’avait donc inscrit à la medersa coranique de Cheikh El Mahfoud pour quelques temps .
Je devais avoir quatre ans. Le souvenir vif, on écrivait sur une tablette en bois trouée de haut pour la suspendre en fin de classe à quelque pointe (tagwest) du mur avec un fil. Au fait les enseignements étaient simples. Sous l’œil vigilant du maître, Il s’agissait d’écrire des versets du Coran d’une plume de rosier imbibée d’encre à base de brûlé de laine appelé « smekh », d’apprendre, sous peine de frappes sur le plat du pieds « falaqa » et de les plasmodier par la suite après avoir effacé l’ardoise de bois avec une substance appelée « tsnachir » la laver avec de l’eau et la laisser sécher pour la reprendre le lendemain ma mère connaissait déjà quelques versets appris de ses seuls six mois d’écoles de sa vie à Ikherbane .
A cette époque, on était loin de s’en rendre compte des enseignements encore moins de leur utilité, l’intéressant était d’accompagner ces meutes d’enfants de tout age dans le brouhaha au milieu de disputes infantiles jusqu’a notre maison ou mon grand père me recevait avec la même question : « qu’es ce que tu as appris aujourd’hui ». De toute évidence il n’avait jamais eu de réponse mais il la reposait de même autant de fois.
Je devais avoir quatre ans. Le souvenir vif, on écrivait sur une tablette en bois trouée de haut pour la suspendre en fin de classe à quelque pointe (tagwest) du mur avec un fil. Au fait les enseignements étaient simples. Sous l’œil vigilant du maître, Il s’agissait d’écrire des versets du Coran d’une plume de rosier imbibée d’encre à base de brûlé de laine appelé « smekh », d’apprendre, sous peine de frappes sur le plat du pieds « falaqa » et de les plasmodier par la suite après avoir effacé l’ardoise de bois avec une substance appelée « tsnachir » la laver avec de l’eau et la laisser sécher pour la reprendre le lendemain ma mère connaissait déjà quelques versets appris de ses seuls six mois d’écoles de sa vie à Ikherbane .
A cette époque, on était loin de s’en rendre compte des enseignements encore moins de leur utilité, l’intéressant était d’accompagner ces meutes d’enfants de tout age dans le brouhaha au milieu de disputes infantiles jusqu’a notre maison ou mon grand père me recevait avec la même question : « qu’es ce que tu as appris aujourd’hui ». De toute évidence il n’avait jamais eu de réponse mais il la reposait de même autant de fois.
Une année plutard je faisant l’entrée précoce à l’école publique au village Tabouda en 1972 dans un édifice lègué par les français et qui devait faire office d’école d’apprentissage pendant les dernières années de la guerre de libération nationale. J’ai été donc accueilli dans ce bâti en préfabriqué à Amrij transformé ,plutôt gardé en école de l’Algérie indépendante .
Les ateliers de menuiserie témoignaient encore aux cotés de celles de la couture par leur présence que les machines ont désertées au profit de maisons du village nous dit on. Un terrain de volley-ball et de pétanque embellis par quelques frênes aux ombres dures de l’été et deux habitations pour les maîtres éloignés dont l’une été occupée par un certain Hochine maître de français amplissaient le decor qui devait aussi temoigner de l'ambiance , alors que la plupart des professeurs du primaire étaient des gens du village : Boujemaa Rabah, Aberbour, boualayoune makhlouf, Boufalla mohand salah , benabdella boussaad….une sorte d’équipe arabisée qui a porte le flambeau et la tache lourde de nous faire comprendre le peu qu’ils savaient du monde mais qui nous a permis néanmoins d’être lucides éveillés et quelque peu intelligents.
L’ambiance était chaude conviviale enclin a l’enthousiasme de l’après indépendance ou les valeurs nationalistes et le sérieux dans le travail avaient encore leurs place, les maitres étaient respectées plus que les marabouts et redoutés plus que nos parents. A cette époque les samedis et les dimanches étaient encore des journées de repos hebdomadaires même si les enseignements étaient dispensés en langue arabe dans leurs trois piliers principaux « écrire, lire et compter ».Ma grand-mère (que Dieu lui accorde sa miséricorde) particulièrement vigilante faisait des visites improvisées et se rendait aux maitres, chez eux même, pour s’enquérir de l’évolution et l’éducation de l’élève que j’étais, a cette époque il n’y avait pas de cadre formel pour le faire sinon a travers les réseaux familiaux tramés depuis l’existence de ces villages kabyles ou tout le monde connaissait tout le monde .
En compagnie de Ouamara Mohand Akli dit « Bouhou » et quelques temps de Bahloul hamimi , amis de la première enfance et fils d’immigres kabyles tout comme moi nous faisions la même classe a Tabouda étant du même âge « Tizya » . Je passais donc chez les oncles de Mohand Akli chez les Barache, en traversant la ruelle familiale une sorte de chemin sans issue exclusif, ou il fallait faire expressément attention au chien de da yahia, une bête de couleur de race maghrébine et de comportement aussi, car il attaquait a l’improviste au dos après que la personne soit parti. On y arrivant, après plus de peur que de mal, sa mère nous offrait un lait chaud de chèvre ou de brebis bouilli sur un coin de feu « el kanoun » une sorte de trou de 30 centimètres de diamètre sur le quel un feu de bois d’olivier mélangé a du genet « adherdhaq » ou bruyère "afouzel" est allume pour cuir les aliments et chauffer la maison pendant les froids.
En quittant cette tendresse singulière que seules les femmes kabyles en avaient on prenait le chemin vicinal traversant le village jusqu'à la dernière maison des at l’mouloud qui nous introduisait dans les champs avoisinants "timizar" d’akhwnaq oufella . il fallait arriver a temps, mais le jeu et l’appel de la nature nous faisait quelques fois du retard soit pour des disputes, des parlottes ou des virées dans les champs voisins pour voler le fruit de saison , a la rentrée les dernières figues de septembre particulièrement difficile a dénicher nous faisaient dérouter , par la suite c’est les figues de barbarie ,les grenadier, les aubépines, les glands,...jusqu'à l’arrivée de l’hiver qu’il fallait affronter avec le peu de moyen du monde rural , les chaussures trouées et quelques vêtements recousues cachés sous un petit burnous ou une kachabia mais qui laissaient infiltrer les pluies rigoureuses qu’accompagne le vent glacial de nos montagnes qui nous fait rougir les joues et glacer les mains en grandissant la hâte d’y arriver en classe ou un poêle a mazout nous réchauffait .En ces temps il n’a pas beaucoup de choses a faire sinon en temps d’éclaircies et de repos tendre les pièges aux charbonniers et aux grives...
Au retour de classes et parfois avant on se permettait a jouer, aux débuts a tixxamine n’chitane, a traduire par les coins du diable, un jeu qui commencait deja a disparaitre et qui consiste a jouer à deux à l'aide de noyaux d'olives (hiver et au printemps). On creuse huit trous symétriques sur deux lignes. Au milieu de ces huit trous, un neuvième qui sert à emmagasiner le gain des adversaires. Chaque joueur possède 24 noyaux placés par groupe de six dans chaque trou sauf dans le trou central. Les joueurs doivent à tour de rôle déplacer cinq noyaux en les mettant un à un dans les divers trous le dernier noyau placé, enlève les noyaux se trouvant dans le trou. Le joueur qui a obtenu le plus de noyaux est le vainqueur.


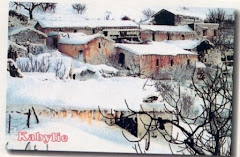







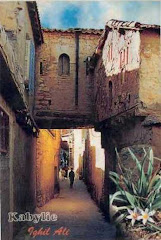



Azul ammis tadarthiw.......
RépondreSupprimerthannemirth thamokrante af ayni ith-khedmadh awk..........
s.barache